
(interview proposée par Booya)
Dans les sociétés arabes, on ne peut pas échapper à la sexualité de l'autre",
remarque Abdellah Taïa. Lui qui a vécu son enfance dans une famille nombreuse de Salé, il raconte un quotidien où l'imaginaire religieux vient se mêler aux désirs du corps, puis la montée à Paris et la prise de conscience du chemin à parcourir pour devenir soi.Fluctuat.net :
Comment vous est venue l'envie d'écrire et qui plus est, d'écrire en français alors que l'arabe est votre langue maternelle ?Abdellah Taïa : Je n'ai jamais rêvé de devenir écrivain. C'est quelque chose qui m'est tombé du ciel, qui s'est emparé de moi. C'est le cinéma qui m'a amené à l'écriture. Enfant et adolescent, il m'obsédait jour et nuit. Je collectionnais les photos des acteurs, des réalisateurs et je rêvais de devenir réalisateur. Deux ans avant le bac, j'ai écrit à la Fémis pour savoir comment passer le concours. L'école m'a répondu qu'il fallait avoir le Deug. Alors, je me suis dit, puisqu'un jour, je vais aller en France, puisqu'un jour, je vais passer ce concours et qu'un jour, je vais devenir réalisateur, autant approfondir mes connaissances en langue française. J'appartiens à une famille pauvre, sans moyens, si ce n'est peut-être des moyens intellectuels, en tout cas l'envie d'avoir des moyens intellectuels. Je n'avais pas fait mes études dans les écoles ou les lycées français qui sont réservés aux gens riches. Je venais de l'école publique où le français qu'on nous enseigne n'est pas suffisamment bon. J'étais incapable d'écrire correctement ou bien de développer une idée. Tout de suite, en arrivant en fac à Rabat, au contact des autres étudiants qui venaient des lycées français, je me suis rendu compte que j'avais énormément de lacunes. J'avais le choix. Soit abandonner le français et en même temps le rêve du cinéma, soit m'accrocher. Ce que j'ai décidé de faire. J'ai donc banni la langue arabe. Définitivement. Je ne lisais plus en arabe. Je ne parlais plus arabe qu'avec ma famille. Et le français est devenu ma priorité, mais aussi la langue avec laquelle j'entrais en conflit. Parce que c'est une langue qui est contrôlée et qui a été conquise seulement par les gens riches du Maroc qui, pour installer une différence entre eux et le reste des Marocains, parlent en français. J'ai toujours ressenti ça comme une agression, comme quelque chose de traumatisant, qui me rappelait en permanence à quel point j'étais inférieur par rapport à ces gens-là, que je ne serais jamais comme eux qui peuvent s'exprimer dans une langue que la plupart des Marocains ne peuvent pas comprendre, de façon profonde en tout cas. Même après, quand je commençais à m'intéresser plus sérieusement au français, ce sentiment de conflit, ce sentiment que ce n'était pas ma langue, que c'était quelque chose qui était d'ordre intellectuel, qui ne m'appartient pas et qui ne m'appartiendra jamais complètement, est resté. J'ai parfois un sentiment de révolte. Parce que, pour moi, c'était une humiliation permanente en langue française. Mon humiliation ! Par des gens qui croyaient que le Maroc leur appartenait. Je le ressentais de façon très violente. Et je pense que l'humiliation est un moteur qui incite à créer. Tout ça n'était pas conscient de ma part. C'est a posteriori que je me fais cette réflexion-là.
Mais maintenant, ce sentiment-là s'est un peu apaisé, non ? Vous prenez du plaisir à écrire en français ?À la fac, j'ai décidé de tenir un journal intime en langue française où j'écrivais tout ce qui se passait dans ma vie, tous les films que je voyais. Petit à petit, ce journal s'est transformé en quelque chose de plus construit, sans que je le décide. Je me suis aperçu que j'écrivais ma vie sous forme de petits textes. L'écriture a commencé en moi, sans même que je m'en rende compte. Dans l'acte d'écrire, il y a un plaisir, mais il y a aussi un conflit. Ce sentiment que je ressentais à ce premier contact à la langue française quand j'étais enfant et adolescent, me reste. Rien n'est acquis.
À Salé, votre ville natale, vous aviez accès au cinéma ?C'est ça qui est formidable ! Même élevé au rang d'art, le cinéma est resté un art très populaire. Encore aujourd'hui, au Maroc, il y a des cinémas où l'on ne va pas voir tel ou tel film, on y va pour la salle, la réaction du public, et aussi les engueulades avec le projectionniste qui coupe les scènes de baiser ou les scènes de sexe. Alors que ce qui se passe de sexuel à l'intérieur même de la salle de cinéma est incroyable. Il y aussi les disputes, la drague, la consommation de haschich ! Cette fête, ça a été mon premier contact avec le cinéma. Les films qu'on projetait dans les salles de mon enfance étaient des films indiens et des films de karaté. Parallèlement, il y avait des merveilles cinématographiques qui atterrissaient là par je ne sais quel accident. Il était une fois en Amérique, Il était une fois dans l'Ouest de Leone, Rendez-vous de Téchiné, Bertolucci, Bunuel - Le Charme discret de la Bourgeoisie - juste après un film de Bruce Lee, même un film de Satyajit Ray, Le Salon de musique. C'est inouï ! Évidemment, à l'époque, je n'avais aucune capacité pour mesurer la différence entre un film de Satyajit Ray et un film de Bruce Lee. Mais, dans ma tête, comme il y avait une sorte de religiosité par rapport à l'image, j'étais capable de recevoir tout et d'aimer tout.
"...."
La sexualité, précisément, est un thème important dans vos livres.Pour moi la sexualité… Comment dire… La sexualité n'a jamais été un problème. Il faut dire que je ne suis pas un modèle de virilité et de machisme marocain. Donc j'étais très libre par rapport à ça. J'étais tout le temps dans une atmosphère un peu sexuelle. Dans les sociétés arabes, du fait de la promiscuité, on ne peut pas échapper à la sexualité de l'autre. En tout cas aux manifestations de la sexualité de l'autre. Ça commence par celle des parents. Je savais à peu près tout de leur sexualité. Je savais quand ils faisaient l'amour, quelle nuit. Même avant, je voyais les prémices. Je dirais presque que je les entendais dans la nuit, même si c'était peut-être davantage dans mes rêves ! Je voyais ce qui se passait le lendemain puisqu'il faut se laver parce qu'on est impur après l'acte d'amour. On n'avait pas de salle de bains. Tout se passait dans une sorte de toilette à la turque. On faisait chauffer de l'eau dans des gamelles qu'on transportait dans ces toilettes pour se laver. Il y avait aussi mes sœurs qui se servaient de moi comme prétexte pour aller chez leurs petits copains en disant qu'elles allaient juste se promener. Moi l'homme, j'étais chargé de les surveiller. Pendant que mes sœurs étaient dans la chambre avec leur copain, j'attendais. Elles me donnaient des bonbons, des glaces. Je regardais la télé. Ce n'est pas du tout quelque chose qui m'a gêné (rires). Peut-être que je suis un peu fou, mais je vous donne un exemple de la sexualité. Elle était peut-être non dite mais, dans les sensations, dans l'atmosphère, elle était présente en permanence. Et à partir de cette échelle familiale, on peut l'élargir à l'échelle de Rabat. Quand vous sortez dans la rue, c'est d'ailleurs quelque chose qui me frappe beaucoup quand je vais au Maroc maintenant, je me rends compte à quel point ce pays est débordant de sexualité ! Autant la sexualité est effacée dans la rue en Europe et en Occident, si ce n'est sur les panneaux publicitaires, autant dans la rue au Maroc, les gens se comportent d'une manière outrageusement sexuelle ! Du fait peut-être qu'on ne peut pas dire les choses…. C'est invraisemblable. Comment peuvent-ils être habillés, marcher, se draguer de cette façon, se jeter de pareils regards ? C'est un jeu sexuel permanent. Le fait d'avoir vécu dans cette atmosphère, ça m'a toujours paru naturel. Dans mon écriture, ça doit se voir un peu. Mais c'est juste comme cette atmosphère-là. Naturelle. Je ne me pose pas de questions par rapport à ma sexualité, à mon homosexualité. Ce n'est pas quelque chose qui m'obsède, qui me taraude ou me pose problème.
Il y a une initiation sexuelle entre garçons ?Ah oui ! Absolument. Moi-même, j'ai eu une sexualité enfantine. Il y a une initiation entre enfants et avec des hommes entre 20 et 30 ans. Ça se passait de façon très naturelle. Je n'ai jamais été choqué.
Vous n'en conservez pas un traumatisme?Jamais. Je pense que je ne suis pas le seul. Et je tiens à le dire, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, par rapport à la pédophilie notamment. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames et que malheureusement, on tombe dans un certain moralisme qui nuit beaucoup aux racines grecques et romaines de la culture occidentale. D'un côté on donne une certaine liberté, plus ou moins, à l'homosexualité et en même temps, on est en train de s'enfermer dans un certain « politiquement correct » que je trouve infernal. On reproche à l'Amérique certaines choses, mais en même temps, on se rend compte que l'Europe vit la même chose. Je trouve ça très malheureux.
Vous avez pu vivre votre homosexualité au Maroc ?Oui, mais je ne l'ai pas vécue dans le sens européen. Pas dans une reconnaissance. Ma mère ne le savait pas. On ne peut pas dire les choses, on se sent enfermé, bloqué, étouffé. Mais parallèlement à ce non-dit, je pouvais vivre tout ce que je voulais. Ça n'empêche pas que j'avais des angoisses, des conflits, des accès de pessimisme, mais qui n'étaient pas liés à la sexualité ou à l'homosexualité.
Le fait de ne pas pouvoir parler de votre homosexualité à votre mère, c'était douloureux pour vous ?Non. C'est pour ça que j'insiste. J'ai vécu mon homosexualité au Maroc, pas d'un point de vue occidental. Pas comme un Occidental la vivrait. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas en train d'idéaliser la société marocaine. Je dis juste comment moi j'ai vécu les choses. Et d'ailleurs, quand on essaye de transposer, c'est là que le malentendu apparaît. De même pour le lesbianisme. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses au Maroc qui ne sont pas encore dites. Mais j'ai vu au Maroc des choses qui se passent entre femmes. Ne serait-ce que pour mes sœurs. C'est indéniable.
"...."
Et puis il y a aussi cet espace collectif où les corps se mettent à nu, le hammam. C'est un lieu important pour vous ?Oui. Absolument. C'est un lieu où il n'y a pas forcément une sexualité, mais une sorte de sensualité, une relation avec le corps de l'autre et ça c'est très, très important. Pour nous, c'était un lieu de passage obligatoire, ne serait-ce qu'une fois par semaine puisqu'on n'avait pas de salle de bains. On ne se lavait qu'une fois par semaine et je garde un goût pour ça. Parfois, ici à Paris, quand je sais que je ne vais pas voir du monde, je reste deux ou trois jours sans me laver. J'adore ces odeurs qui émanent de moi et que je ne garde que pour moi. Peut-être va t-on me prendre pour un cochon ! Si vous ne vous êtes pas lavés pendant trois ou quatre jours, quand vous le faites, l'impact de l'eau sur la peau n'est pas pareil. Et vous avez vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe.
"...."
Ça vous a manqué ce contact physique quand vous êtes arrivé à Paris ?Oui. Devenir un individu, ça veut dire être seul, s'accepter et assumer tout seul, ce n'est pas quelque chose d'évident. Vraiment, même pour quelqu'un comme moi qui a lu, qui a un bagage intellectuel… Je dirais même que c'est un traumatisme. Pour devenir un individu, ici, à Paris, ça n'a pas été facile. De la même façon que ça n'a pas été facile, de s'extirper là-bas du groupe pour pouvoir garder ne serait ce qu'un espace pour soi.
Si vous étiez resté au Maroc, votre mère aurait voulu vous marier à une jeune femme. Il aurait été difficile de refuser.
Evidemment, je me pose cette question-là. De toute façon, elle me le disait déjà avant même que je ne parte. Mais, je prenais ça pour la dictature quotidienne de ma mère. Mais je ne sais pas ce que je serais devenu si j'étais resté là-bas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une homosexualité claire et nette. Il n'y a pas de doute sur ça.
"...."
Est-ce que vos livres sont lus au Maroc à la fois par des intellectuels et des gens de votre famille ?Ma famille a eu accès à des premières nouvelles que j'ai publiées dans des recueils collectifs et au premier livre Mon Maroc (Séguier, 2000). Le deuxième livre, Le Rouge du Tarbouche (Séguier, 2004) va être bientôt édité en français par une maison d'édition marocaine. Mes frères et sœurs lisent le français, mais ma mère est analphabète. Ils lui disent de quoi je parle.
En lui cachant votre homosexualité ?Je ne sais pas. Ils ne le savent pas. Enfin…. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Je ne veux surtout pas penser à ce qui va se passer au moment de la réception d'un de mes livres. Et ça ne me donne aucune angoisse. J'essaye de me vider la tête par rapport à ça.
La religion tenait une part importante dans votre vie quand vous étiez enfant, adolescent ?La religion au sens où c'était un cadre de vie, pas au sens où il y avait des obligations de prière, de respect de tous les principes et préceptes de l'islam. C'était plus une religion comme atmosphère, comme lumière, comme odeur, comme ma mère dans son bordel religieux, qu'autre chose. Par exemple, on ne m'a jamais obligé à prier. La seule chose qu'on m'a obligé à faire, c'est le ramadan. Au Maroc, on peut ne pas respecter les autres préceptes, mais ne pas faire le ramadan, ça passe mal. Mais c'était la fête pendant trente jours. Je le faisais avec plaisir. Surtout, ce que j'aimais dans l'Islam, en tout cas celui que j'ai vécu dans les années 1970 et 1980, c'était le paganisme. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui se mélangeaient à l'Islam (*), comme le culte des saints. C'est ce qui m'a le plus marqué. Dans mes livres, je parle toujours des saints, de la baraka. J'ai été initié à ça. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu…Je vais dire un mot peut-être un peu choquant…. Mais… Les partouzes ! Ce que c'est un mausolée de saints au Maroc ! C'est un lieu d'une liberté extraordinaire. C'est à la fois un respect d'Allah, de certaines règles, mais pas toutes et l'instant d'après les gens boivent du vin, ils s'accouplent, ils sont possédés, ils croient qu'il faut satisfaire ces Djinns (démons) qui les habitent. C'était une atmosphère de folie qui me ravissait.
Qui sont saints ?Au Maroc et en Islam en général, une personne devient saint ou sainte après sa mort seulement par la ferveur populaire, parce que les gens l'ont aimée. Ils honorent sa tombe et avec le temps, ça conserve à cette personne une certaine aura. On construit un mausolée, puis on organise une saison de pèlerinage. En réalité, beaucoup de ces saints n'ont pas eu une vie si pieuse que ça. Au contraire. Beaucoup étaient presque des mécréants, des gens qui vivaient dans le pêché, pour reprendre un mot religieux qui ne veut rien dire dans le cadre de ces mausolées. Je suis lié à la fois à ces saints, à ces mausolées, à ce qui s'y passe et à la folie. Le Maroc est un pays fou ! (rires) La folie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup… Peut-être parce que moi-même je dois être un peu fou. Nous devons tous avoir en nous des germes de la folie.
Que voulez-vous dire quand vous dites que le Maroc est un pays fou ?Les gens vivent dans l'irrationnel complet, avec une croyance sincère dans la sorcellerie. D'ailleurs, si vous voulez comprendre les Marocains, il ne faut absolument pas dire « mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils croient à la sorcellerie! » La question ne devrait même pas se poser. Tout le monde y croit. Et tout le monde fait de la sorcellerie. Enfin je veux dire…. Pas moi, évidemment ! Mais c'est une clef importante pour comprendre, à la fois, la personnalité, la psyché, la religion et la société marocaine. C'est tout ça pour moi l'Islam et aussi l'appel à la prière. C'est une musique qui me manque beaucoup ici à Paris. Cette voix qui s'élève cinq fois par jour, qui gêne certaines personnes et qui ne m'a jamais gêné.
Que pensez-vous de la situation du Maroc aujourd'hui, sous le règne de Mohammed VI ? Ce qui se passe en ce moment au Maroc est à la fois réjouissant et malheureux. Il y a des choses qui incitent à rester optimistes et d'autres qui, au contraire, font que je me demande comment les gens font pour réussir à survivre avec tant de misère. Par exemple, il y a au Maroc, c'est indéniable, la formation d'une société civile. Ça se voit à tous les niveaux. Il y a une vraie liberté de parole. Mais d'un autre côté, il y a une vraie misère qui fait le terreau de l'islamisme extrémiste qui est, quoi qu'on dise, en train de germer et de s'installer dans les quartiers populaires.
Si on prend l'exemple de votre famille ? Heureusement, tous mes frères et sœurs ont pu faire des études. Ils ont trouvé du travail, ils ont de très bons postes. Nous ne sommes pas devenus des bourgeois, mais nous avons un bon niveau de vie. Nous ne sommes plus pauvres. Nous avons de quoi manger. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais enfant. Mais quand je retourne dans mon quartier, je vois que les gens sont de plus en plus pauvres. Ça m'inquiète beaucoup. La misère, la pauvreté, c'est le meilleur moyen pour encourager l'extrémisme. L'Islam extrémiste peut donner un sens à la vie d'une personne pauvre qui est extrêmement fragile. N'importe qui peut venir et lui faire un lavage de cerveau en lui disant : « Si vous mourez, vous serez au Paradis, vous ne serez pas seul. » Etre un élément parmi tous les musulmans, ça donne un sens à l'existence. Le gouvernement ne fait pas assez pour les gens. Et en même temps, est-ce que c'est le gouvernement qui doit tout faire pour ce peuple ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des richesses dans ce pays qui sont volées et qui sont l'apanage d'une petite minorité de Marocains. Le reste des gens n'a rien.
"...."
Dans vos ouvrages, il y a une part de réflexion philosophique. Est-ce que c'est lié à votre culture islamique ? Oui, il y a une certaine sagesse. Ça se traduit souvent à la fin de chaque récit. Il y a, non pas une morale, mais une manière de revenir sur le récit, non pour le résumer mais pour dire « voilà, c'est ça ». Ça doit provenir de la structure des contes oraux, au Maroc et dans le monde arabe.
Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Souvent, après avoir raconté l'histoire, on la résume en deux ou trois lignes. J'essaie dans chaque texte de boucler ce que je raconte. S'il y a une morale, c'est simplement la mienne, celle de ma vie. Ça se voit encore plus dans les livres d'un compatriote que j'aime beaucoup, Rachid O, un écrivain homosexuel de 34 ans. Quand j'étais au Maroc, ça a été pour moi une énorme découverte.
Aujourd'hui, quelle place occupent la littérature et le cinéma dans votre vie ? Le cinéma prime plus que la littérature. J'ai des idées de scénarii. Mais, quand j'ai compris que ma famille n'avait pas d'argent, que je ne connaissais personne à Paris, que même pour obtenir le visa pour aller en France ça allait être comme escalader l'Everest, quelque chose en moi s'est apaisé qui m'a appris non pas à renoncer, mais à retarder certaines choses. En ce moment, j'écris des textes où le « je » et la fiction interviennent. Ce que je lis après n'est plus moi, ça devient autre chose. Là encore, c'est la leçon de Proust. A partir du moment où l'on manipule les mots, où l'on joue sur le ton, la chronologie, les épisodes, les couleurs, il y a quelque chose de nouveau qui émerge et qui me surprend, moi le premier. J'ai un projet d'écrire sur le plus grand amour de Jean Genet, Abdallah le funambule qui s'est suicidé quand Genet l'a délaissé. J'adore Jean Genet, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et quelque part, c'est un écrivain marocain.
Il est également cinéaste.Oui et il a fait un des plus beaux films qui soit dans l'histoire du cinéma, Un chant d'amour. C'est un film muet, qui revient aux origines même du cinéma. Un film vraiment extraordinaire. Je serais volontiers un fils de Jean Genet.
Laure Naimski -
Lire la suite...




 Lire la suite...
Lire la suite...
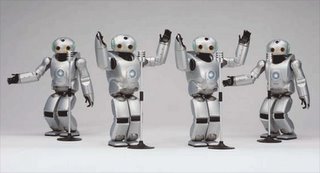




 Lire la suite...
Lire la suite...

 Lire la suite...
Lire la suite...

 Lire la suite...
Lire la suite...


 Lire la suite...
Lire la suite...
